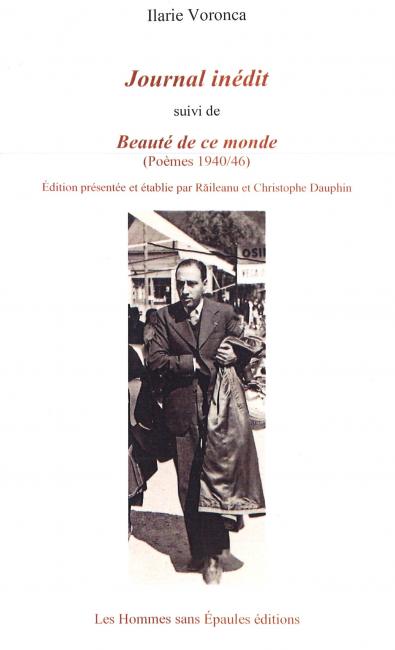
Ilarie Voronca, poète de deux langues et deux patries, est connu dans son pays natal surtout comme l’un des protagonistes des avant-gardes. Pendant dix ans il déploie une activité frénétique et il n’est pas faux de dire que l’enthousiasme, l’extraordinaire disponibilité, l’optimisme, la foi en l’avenir propres au mouvement roumain d’avant-garde lui sont, du moins en partie, redevables. Les textes publiés dans les revues de l’époque, Contimporanul, 75 HP, Punct, Integral, unu : poésies, articles théoriques, manifestes, commentaires, proses, recueillis dans douze livres, sont entrés comme pièces fondamentales dans le corpus de l’avant-garde historique roumaine et l’exégèse consacrée au phénomène les reconnaît comme tel. Paradoxalement, l’histoire de la littérature roumaine peine à intégrer le moment avant-garde et la plupart des commentaires critiques s’emploie à dissocier l’œuvre « sérieuse » des protagonistes, dont Voronca, des extravagances avant-gardistes reléguées définitivement aux quelques publications éphémères et validées seulement comme objet de recherche universitaire.
« Milliardaire en images », la formule souvent citée du critique littéraire E. Lovinescu, affirme un aspect réel de l’écriture de Voronca, mais elle établit en même temps un stéréotype durable d’interprétation : « simple juxtaposition d’images préjudiciable à l’unité du poème ». Le plus souvent les textes du poète ont été interprété avec d’autre critères et introduits dans d’autres systèmes de références que celles de la « poétique » avant-gardiste et de son propre programme formulé dans des articles-manifeste tels Aviograma et 1924 (75HP, octobre 1924), Gramatica/Grammaire (Punct No 6-7, 1924) et Voci/Voix (Punct No 8, 1925), Cicatrizări. Poezia nouă/Cicatrisations. La Poésie nouvelle (Integral No. 1, 1925), Între mine și mine/Entre moi et moi(unu No 19, 1929)[1]. Briser l’unité du poème ainsi que la préférence donnée au fragment, à l’imperfection, à l’inachevé font parti de ce programme, au même titre que le détournement des règles de la grammaire, le rejet du symbole et de la métaphore au profit des « associations-éclair ». Il y a, écrit Voronca, « une saveur presque sensuelle dans l’enchainement des mots, au delà de leur sens ». Ce n’est pas la peine de lire cette poésie si le lecteur n’est pas capable de se placer au même degré d’ « exaltation » que celle dont elle est l’expression, semble dire Voronca dans un article de 1927 : « dans un poème on ne peut pas pénétrer par l’entendement, mais à travers une exaltation telle une injection de morphine »[2].
L’exubérance du poète est bien servie par sa capacité hors du commun de produire des images. Loin d’être décoratives et extérieures ou un exercice de virtuosité, ces images créent un réseau inédit de métamorphoses et correspondances. L’émerveillement devant la vie, devant l’univers, devant l’amour donne à la poésie de la période roumaine une fraîcheur particulière : les textes de cette époque captent le son du bonheur. Ni le lexique résolument moderne, ni l’abandon de la syntaxe n’enlèvent aux textes de Voronca leur souffle lyrique singulier.
La création poétique de Voronca connaît plusieurs métamorphoses – symbolisme, dada, pictopoésie, mots en liberté futuristes, constructivisme, intégralisme – mais elle garde toujours une force de suggestion hors-norme due à la puissance analogique des images. Avec le recueil de 1928 Ulise/Ulysse (traduit en français par Roger Vailland et publié sous le titre Ulysse dans la cité, éditions du Sagittaire, 1933) et Brățara nopților/Le Bracelet des nuits, 1929, le discours poétique gagne en ampleur et témoigne d’un élan fraternel qui embrasse l’univers et ses habitants. Fidèle à son engagement théorique en faveur de l’intégralisme, sorte de synthèse de toutes les tendances avant-gardistes seule capable de raccorder la création à la complexité de la vie moderne, mais auquel le poète donne aussi un sens plus large, celui de dire oui à la vie, Voronca compose des textes d’allure hymnique. Les romantiques allemands Novalis et Hölderlin résonnent dans ces textes et Whitman a été souvent évoqué en rapport avec cette période de création. Cependant, Voronca réinvente l’hymne, enraciné désormais dans le quotidien médiocre dépourvu de mystère et auquel il infuse le lexique citadin-industriel :
« Je te dédie un hymne siècle de la médiocrité
Dans les montagnes de l’Amérique nous ne chassons plus l’ours grizzly
Nos bras ne saignent plus les forêts vierges
Nous opérons nos rêves comme on opère des intestins
Nous nous enfermons nous-mêmes dans la moisissure des bureaux
Le matins les dactylographes embrassent leurs fiancés
Elles ne les reverront qu’à l’heure nocturne
Où elles feront l’amour sur des matelas de paille
Mais dans l’air nos âmes se rencontrent
Au-dessus des toits nous bâtissons un autre ciel de chair
Siècle des assurances sur la vie et des enseignes lumineuses
C’est l’heure où les Anglais applaudissent la danseuse espagnole
Et refusent le bouquet de violettes
Les jets d’eau crachent des étoiles
Les grands quotidiens grincent des dents
Et voilà que les agents des compagnies d’affichage
Changent le linge des murs ».
Le siècle médiocre avec son cortège de métamorphoses changent la face du monde et bousculent la vie des hommes. L’homme, plus que jamais, est conditionné par les circonstances extérieures, balloté par les vagues de sa propre amnésie. Il est cet Ulysse errant à la recherche de l’improbable Ithaque, d’un chez soi de plus en plus abstrait, de plus en plus improbable :
« Tu te penches vers toi comme vers l’assiette du ciel peinte de
couleur
Tu rôdes autour de toi comme autour d’une maison dont tu aurais
Oublié le numéro
Tu sonnes tu cries tu appelles le propriétaire tu lui demande si
c’est toi qui habites en toi
Panique panique
Le désespoir jette des signaux
L’effroi dénoué coule jusqu’aux chevilles
Tu cherches tes sandales ton souvenir tes épaules
OÙ SUIS-JE ?
Quelle est la longitude de ton cœur ?
Tu essaies de te ramasser toi-même parmi les restes de la nuit
LE MÊME
UN AUTRE
UN AUTRE
LE MÊME ».
Mais cette réalité, source de souffrance et désolation, n’est pas incompatible ni avec la poésie, ni avec le bonheur, ni avec le rêve. Devant la ville, l’émerveillement de Voronca rappelle les Illuminations de Rimbaud, les Villes, « défilé de fééries », qui intègrent dans la vision du poète les formes gigantesques et éloignées de la nature et une déclinaison inédite du miraculeux : « Ce sont des villes ! C’est un peuple pour qui se sont montés ces Alleghanys et ces Libans de rêve ! Des chalets de cristal et de bois qui se meuvent sur des rails et de poulies invisibles »[3].
Dans Ulysse, les âmes qui se rencontrent dans l’air et le « ciel de chair » bâti au-dessus des toits de la ville ne sont pas sans rappeler les tableaux de Marc Chagall avec ses personnages planant dans les airs, expression plastique directe du désir de liberté et du pouvoir de l’amour, sorte de dérade (mot inventé par Rimbaud dans Le Bateau ivre pour dire sortir de rade, s’évader, prendre le large) naïve et jubilatoire, qu’un autre peintre venu de Roumanie, comme Voronca, Jacques Hérold, peindra à sa manière. C’est ce même mouvement ascensionnel que Chagall donne au portrait de Voronca offert pour le recueil Ulysse où le poète est représenté en guise de Tour Eiffel. Nous ne savons pas dans quelles circonstances Voronca et Chagall se sont rencontrés à Paris, peut-être dans le cercle des réfugiés russes réunis autour de l’imprimerie Union, où Voronca avait édité, entre 1927-1929, cinq recueils de poésies en roumain portant mention COLECȚIA INTEGRAL[4]. De toute évidence, ils ont en commun la capacité d’élever au rang de miracle les joies simples et même les contraintes de la vie. Ainsi pourrait-on étendre à Voronca ce propos de Fondane à l’égard de Chagall : « Voici des hommes qui nous font toucher du doigt les miracles[5] ».
Ulysse est « un hymne à toi, siècle de la médiocrité », et les réalités humbles du quotidien ont droit au même traitement comme éléments d’une nouvelle mythologie : un hymne au savon CADUM et au thé, à l’individu dont le destin est « distributeur mécanique », un hymne à la marchande de quatre saisons et aux fruits de la terre, un hymne à l’hôpital, aux trains-coupe papier du paysage, aux miroirs, aux boulevards, aux salles de gymnastique et aux terrains de tennis, un hymne à Paris, « huile fortifiante pour la jointure de la pensée ». Entre Paris, où il écrivit le début du poème Ulysse, et qui deviendra sa ville, et Braïla, port du Danube, lieu de sa naissance, Voronca déroule à rebours les référents d’une géographie qui embrasse toute la planète et révèle son penchant unanimiste.
Dans Brățara nopților/Le Bracelet des nuits, l’hymne s’étend aux éléments et aux phénomène naturels, la mer, la nuit, les orages, dans un jeu de définitions fortes et mémorables :
la nuit : « les nuits changent de main comme les habits du riche ;
la mer : « la mer chasse ses meutes de voix » ; « la mer est le gant jeté dans l’arène de la nuit » ;
la montagne : « combien tu es petit devant ces écrevisses géantes les montagnes ».
Et à côté, dans la ville, les lieux d’élection du poète :
la bibliothèque : « les bibliothèques, ces antichambres de l’éternité, ces jardins de l’extase » ;
l’imprimerie : « Typographies, vous êtes les mamelles de la terre ».
Voronca entend concilier dans sa poésie l’homme et la nature, donnant à la poésie un statut d’immanence du réel, comme il écrit dans Cicatrisations. La Poésie nouvelle : « … et la poésie devient tout à coup universellement humaine, poésie-poésie, poésie-ciment, poésie-planche d’ingénieur, cerveau, organisme vivant, intégré simplement entre les phénomènes de la nature ».
A cette époque Voronca se montre préoccupé de donner à ses livres une portée plus générale, à commencer par les titres. Petre Schlemihl, 1932, et Patmos (titre complet Patmos și alte șase poeme/Patmos et autres six poèmes), 1933, renvoient, tout comme Ulysse, à des référents littéraires et culturels universels et dont la sphère sémantique se définit, avec certaines différences de nuance, par errance et solitude. Patmos est l’île grecque où, selon la légende, Saint Jean, retiré volontairement ou en exil imposé, les versions historiques divergent, a écrit l’Apocalypse. C’est ici que le poète place « l’Ile Fantôme », l’endroit qui abolit l’espace (« il n’y a ni Nord, ni Sud, ni Est, ni Ouest » et le temps et où le poète a la révélation (le sens du mot grec apokalupsis) de la poésie comme fonction naturelle :
« Et il n’y a plus de sommeil. Il n’y a plus d’éveil.
Et nous ne pensons à rien. Passé présent
S’amincissent comme un vol de cigognes à travers mon front
Transparent.
Ni attente ni désespoir. Une mer infinie et vieille.
Comment me souvenir ? Sans mots ? C’est ainsi qu’on arrache
ses yeux
Au rossignol. Le rossignol, aveugle, chante des chants plus
beaux.
Qui vint arracher au poète les mots ?
Aveugle des mots le poète chante un chant plus beau ».
Dans le récit de Chamisso L’Étrange histoire de Peter Schlemihl, Ilarie Voronca a pu entrevoir une similitude avec sa propre situation. Le personnage de Chamisso, après avoir vendu son ombre au Diable, voit dans les yeux des autres la conséquence de son geste : il ne le reconnaissent plus comme un des leurs, Peter Schlemihl est banni, condamné à se cacher. Dans un geste de révolte il se débarrasse de la maudite bourse et commence une errance qu’il met au profit de la connaissance et au secours des autres. En 1931, le groupe réuni autour de la revue unu rompe avec Voronca[6] lui reprochant des accointances indues avec l’establishment littéraire : le poète devient membre de la Société des écrivains roumains et son dernier livre Incantații/Incantationsest publié aux éditions Cultura Națională, la plus importante institution du genre de l’époque, consacrée aux écrivains reconnus et capable de consacrer les écrivains publiés. Presque simultanément, Voronca perd son emploie dans le service de presse attaché à la Présidence du Conseil des ministres. Le premier ministre de l’époque, l’historien Nicolae Iorga, grand pourfendeur de toute forme de manifestation de la modernité, aurait lancé un jour en apercevant Voronca dans les bureaux de l’institution : « Nous n’avons pas besoin de modernistes. Qu’il ne mette plus les pieds ici »[7].
Faire acte d’avant-gardisme n’est pas sans danger dans la Roumanie des années 1930, quelques-uns – le poète Geo Bogza, les jeunes du groupe Alge, parmi lesquels Gherasim Luca et le peintre Perahim – ont fait même des stages en prison accusés d’ « outrage à la moralité publique ». Alors que les amis de Voronca lui imputent d’avoir trahi leur combat contre le conformisme et pour l’affirmation de l’esprit moderne, aux yeux des autorités il passe pour un non-conformiste irréductible. Au delà de la partie incidente du récit de Chamisso, Voronca retient le bannissement de Peter Schlemihl et son réveil, dans la deuxième partie, à la solidarité avec ceux qui souffrent. Dans une lettre à Geo Bogza, ami poète qui lui est resté fidèle, Voronca s’explique : « Du célèbre personnage de Chamisso le mien n’a que la houle et l’expulsion de la société des hommes – ainsi que la perte de l’ombre – et en plus un frémissement et tourment pour tout ce qui est souffrance et défaite humaine et aussi une histoire d’amour »[8]. Quelques jours plus tard il revient pour appuyer le message de solidarité et d’humanisme qu’il a voulu délivré : « J’au voulu pour ce livre un horizon beaucoup plus large, plus humain. (Souligné dans le texte) Il y est question de tous les gens, de moi, de toute l’humanité[9] ». C’est ce même message que son œuvre en langue française porte inlassablement. Œuvre française qui prend appuie sur ces trois livres traduits du roumain, dont les deux premiers avec des titres modifié dans le sens mentionné ci-dessus : Ulise devient Ulysse dans la cité et Peter Schlemihl, Poèmes parmi les hommes.
L’image de l’homme que donne Voronca dans Ulysse : « Et tu te cherches toi-même comme un voisin/ qui aurait dormi à tes côtés» ainsi que dans le passage « Tu sonnes tu cries tu appelles le propriétaire tu /lui demande si c’est toi qui habites en toi… » se situe dans la proximité de L’Homme approximatif de Tristan Tzara : « homme approximatif se mouvant dans l’à- peu-près du destin » et illustre ce que André Breton pose dans le premier Manifeste surréaliste comme « applications du surréalisme à l’action » faisant références aux faits et gestes dictés par « la voix surréaliste » et qu’il exemplifiait par un exploit de Philippe Soupault : « De même, en 1919, Soupault entrait dans quantités d’impossibles immeubles demander à la concierge si c’était bien là qu’habitait Philippe Soupault. Il n’eut pas été étonné, je pense, d’une réponse affirmative. Il serait allé frapper à sa porte »[10].
La poésie de Voronca n’a jamais été loin du surréalisme, malgré ses articles des années 1925-1927 lui déniant toute originalité, une position dictée par ses convictions du moment – pictopoésie, constructivisme, intégralisme -, mais aussi par solidarité avec ses amis proches auxquels il vouait une admiration sans faille : Tristan Tzara, Claude Sernet, son beau-frère, et Benjamin Fondane et qui, à l’exception de Tzara, dont les rapports avec Breton et son groupe ont été plus complexes et plus sinueux, ont manifesté une hostilité constante à l’égard du surréalisme. Après 1928, la nouvelle revue unu qui s’impose comme le porte-drapeau de l’avant-garde en Roumanie affirme pleinement son orientation vers le surréalisme. Dans un long article qui est à la fois une confession (Entre moi et moi) et une mise à jour du dispositif théorique, sans écrire une seule fois le mot surréalisme, Voronca reprend les « thèmes » et les exigences de « l’esthétique surréaliste » :
le rêve : « les eaux du rêve se déverseront en torrents blancs, et les représentations avec des lois et des formules seront entrainées dans les abîmes comme les troupeaux du pâtre surpris par la tempête » ;
l’écriture automatique : « C’est comme ces dessins en « linoleum » et la joie du peintre de laisser aller sa ligne dirigée par le glissement du burin sur des entailles imprévues, dans un zigzag du matériau choisi. » ; déjà dans Ulysse l’écriture automatique se signale : « Le sommeil est une machine à écrire » ;
le hasard (objectif) : « Et dans cette célébration des enchaînement des mots, comme les serpents dans les herbes chevelues des rivages, reconnaissons exactement ce côté révélateur du hasard, ces harmonies éveillées accidentellement comme les effluves d’odeurs et d’échos apportées par les navires du vent… – béni soit le hasard ! – » ;
l’image surréaliste et la « soudaineté désirable » des associations postulée dans le Manifeste surréaliste : « Comment se fait-il que les hommes n’aient pas compris que le beau (qu’est-ce que le beau ? le beau peut-il exister ?) jaillit justement de l’imprévu, de l’inédit des associations des idées ou d’objets »[11].
Si tous ces éléments se retrouvent dans sa création, Voronca n’adhère pas au mouvement de Breton et n’est pas un surréaliste. Il choisi ne pas s’enfermer dans une formule, laisser la poésie exprimer librement son acuité sensorielle hors du commun et s’imprégner de ses sentiments mouvants et de ses contradictions.
La dernière métamorphose de la poésie de Voronca est celle déclenchée par l’adoption de la langue française dès 1933 lorsqu’il s’installe en France avec sa femme Colomba. Pour certains écrivains, et Voronca en est un, écrire est synonyme de vivre. Vivre c’est écrire. Comment écrire dans une autre langue ? Car il ne s’agit pas d’une translation mécanique d’un idiome à l’autre. Changer de pays, changer de langue signifie pour un écrivain se situer dans un autre système de références culturels et dans une autre histoire. Une langue n’est pas seulement un moyen de communication, un véhicule, mais aussi une vision du monde. Écrire dans une autre langue c’est se situer dans cette autre vision du monde et parler de soi-même.
Mircea Eliade, lui-même exilé à Paris dans l’immédiat après-guerre, fait l’aveu douloureux de son propre « éloignement physique de la littérature », pour ne se consacrer qu’à ces « livres savants », les seuls, de par leur neutralité scientifique, qu’il puisse écrire dans une langue étrangère, et relate les propos de Voronca à ce sujet : «18 octobre [1945]. Aujourd’hui, chez Mme R.R., j’ai rencontré Ilarie Voronca que je n’avais plus vu depuis 1933. Il me parle de la tragédie qu’est pour lui la composition de poèmes dans une autre langue que la langue maternelle. Comme je le comprends ! Mais les difficultés que j’éprouve à écrire en français des essais ou de la prose scientifique ne sont pas comparables à celles qu’à du affronter Voronca. Comment fait-il pour réussir ? D’autre part, il est évident que la poésie de Voronca en langue française, est autre chose que ce qu’il aurait écrit s’il avait continué à s’exprimer en roumain »[12].
Voronca assume sa condition, de l’errance et de l’impermanence il fait le socle de son nouveau départ et de la déclinaison alternative des contraires, il construit une forme de permanence : « LE MÊME UN AUTRE UN AUTRE LE MÊME ». L’Apprenti fantôme est son propre double qui apprend sa nouvelle existence, qui apprivoise sa nouvelle vie, sa nouvelle langue et la mort :
« Je n’ai pas encore rompu tous les liens
Avec l’être que je viens de quitter.
Je regarde en arrière comme quelqu’un
Qui veut se rappeler le chemin du retour.
Mais je suis si léger, si insouciant.
En même temps ici et ailleurs comme une circonférence
Dont tous les points sont à la même distance
D’un centre qui peut être partout et nulle part ».
Les vies et les œuvres scindées des poètes, écrivains et artistes sont susceptibles d’attirer le risque d’un jugement partial ou, pire encore, celui de l’oubli : dans l’un ou l’autre pays ou dans les deux. Dans les deux cultures, ils sont privés de filiation : Ilarie Voronca, B. Fundoianu-Benjamin Fondane, Mihail Cosma – Claude Sernet, Tristan Tzara, Gherasim Luca sont les exemples les plus proéminents d’une série plus longue.
En France, Ilarie Voronca s’est trouvé un exégète passionné et compétent en la personne de Christophe Dauphin, poète et éditeur, qui lui a consacré une monographie vaste et complète, ILARIE VORONCA. Le Poète intégral. A partir du concept de « poésie émotiviste » Christophe Dauphin propose une anthologie réunissant les poètes ayant en commun cette différence spécifique : « Contrairement aux poèmes qui naissent sans avoir été vécus intensément et ne possède aucune brèche ouverte sur l’intime, le poème émotiviste (que l’on ne saurait réduire à la seule expression des affects) correspond aux enjeux de la vie intérieure, à la traduction des fluctuations de l’être par le langage »[13]. Dans Les Riverains du feu, une anthologie émotiviste de la poésie francophone contemporaine, Le Nouvel Athanor, 2009, Voronca figure aux côtés de Sarane Alexandrian, Joë Bousquet, Jean Breton, Guy Chambelland, Malcolm de Chazal, Patrice Delbourg, René Depestre, Georges Henein, Joyce Mansour, Roger Vitrac et altri.
Le voyage en Roumanie
Ilarie Voronca, pendant les années de guerre, entamme, tout comme ses amis poètes et peintres Victor Brauner, Jacques Hérold, Tristan Tzara, Claude Sernet, une vie d’errement, de solitude et de désepoir. A Marseille d’abord, ensuite dans une ferme du département des Hautes Alpes, et enfin dans le village de Moyrazès, non loin de Rodez, le „proscrit” Voronca trouve refuge grâce à des complicités fraternelles telle celle de Denys-Paul Bouloc, éditeur et poète. Il participe activement à la Résistance, tel que témoigne la lettre du maire de Moyrazès[14]. Après la guerre Ilarie Voronca est nommé responsable des émissions en langue roumaine de la Radiodiffusion Française, et c’est en cette qualité qu’il entreprend un voyage dans son pays natal.
La Roumanie a terminé la guerre du côté des Alliés et se trouve dans un processus accéléré de soviétisation forcée. Le changement du paradigme culturel fait partie de ce processus. En l’espace de quatre ans, la Roumanie accueil Ilya Ehrenbourg, septembre 1945, Ilarie Voronca, présenté comme résistant et directeur des programmes en langue roumaine de Radio Paris, janvier-février 1946, Tristan Tzara, « représentant marquant des communistes français », novembre-décembre 1946, Louis Aragon et Elsa Triolet, juillet 1947, Aimé Césaire, mars 1949, Jorge Amado, juillet 1949, Paul Éluard, novembre 1949. La presse contrôlée par le Parti communiste publie de larges comptes rendus de ces visites et reproduit les déclarations de ces écrivains célèbres en faveur d’une littérature engagée.
Les poètes français et francophones tiennent une place importante dans cette démarche, grâce sans doute à la position dominante de la langue française, dans laquelle s’est formée la majeure partie des écrivains et des intellectuels roumains depuis plus d’un siècle. Mais il y a aussi une autre explication qui a du prévaloir dans le choix des autorités roumaines : la France était le seul pays occidental où, dans l’immédiat après-guerre, les communistes étaient influents. En 1945 est fondée l’Association France-Roumanie siégeant à Paris et dotée d’un mensuel Cahiers France-Roumanie (1945-1948) dans lequel Fondane, Tzara, Voronca, sont souvent présents avec des textes ou évoqués, Eugène Ionesco donne des chroniques de livres et le jeune philosophe Michel (Mihail) Sora, un large panorama de la « pensée française contemporaine ». Autre preuve de cette étroite collaboration, un des premiers livres publiés à la fin de l’année 1946, par les très récentes Éditions d’État est l’anthologie Sang des Poètesqui recueil « la poésie de la liberté, le chant du grand combat » des « plus importants des poètes consacrés, d’Aragon à Éluard, en passant par Pierre Emmanuel et Loys Masson ». Sur les 34 auteurs présents, Aragon et Éluard sont largement en tête avec 28 et respectivement 25 titres, suivis par Pierre Emmanuel, 6, Pierre Jean Jouve et Loys Masson, 5, Pierre Seghers et Pierre-Henry Simon, 3, Jules Supervielle, 2, et les autres, parmi lesquels Jean Cassou, Robert Desnos, André Frénaud, Léon Moussinac, Jean Tardieu, avec un texte. Y sont également accueillis les poètes nés en Roumanie Benjamin Fondane (Berceuse de l’émigrant), Tristan Tzara (Une route seul soleil) et Ilarie Voronca (Beauté de ce monde).
Pour Voronca, le voyage en Roumanie était aussi l’occasion de retrouver, après de longues années de séparation, la femme de sa vie, rencontrée en 1938. Avant de partir, il envoie une lettre à Sașa Pană qui lui avait déjà écrit et envoyé un des deux articles que l’ancien directeur de la revue unu lui avait consacrés dans la presse roumaine. Dans cette lettre datée du 6 décembre 1945, Voronca assure son ami qu’il a changé, tout en étant le même, selon la formule employée dans le poème Ulysse : LE MÊME. UN AUTRE. UN AUTRE. LE MÊME. L’homme Voronca est le même qu’auparavant, mais le poète a changé :
« J’ai changé néanmoins. Ce changement a commencé en moi dès 1933-1934. J’en avais assez de la poésie précieuse et prétentieuse réservée à un nombre réduit de lecteurs. J’en avais assez de la littérature réservée à quelques fils à papa pommadés et méprisants pour le reste de l’humanité. J’ai voulu parler aux hommes pour les hommes, pour l’humanité. Cette évolution s’est précisée avec mon livre « La Poésie commune » (écrit en 1935). Depuis, je suis de plus en plus convaincu que la mission du poète est celle d’être un combattant pour que la justice sociale, la justice pour laquelle tant de camarades sont morts règne sur la terre. Je suis heureux que de constater que ton évolution a été semblable à la mienne. Mon idéal este d’être de plus en plus un poète engagé. Tu comprends que de ce point de vue je suis avec Éluard, Aragon, Guillevic contre Breton et les surréalistes – comme Brauner – qui mènent une politique trotzkiste criminelle ». Voronca ne parle pas directement de son voyage mais le laisse entendre : « Nous nous reverrons peut-être bientôt ». En marge de cette deuxième page de la lettre, en prévision de leur rencontre qu’il sait tout de même certaine et proche, Voronca renseigne son ami sur les changements intervenus dans sa vie privée : « Puisque tu es le même fraternel Sasa de Unu, je te dirai que je souffre beaucoup d’être séparé de la femme de ma vie Rovena Valeanu que j’espère épouser dès qu’elle sera à Paris. Colomba (qui est restée une grande camarade) est la compagne de mon ami le poète communiste Guillevic ».
Était Voronca membre du Parti communiste en décembre 1945 ? La documentation dont nous disposons ne permet pas une réponse catégorique[15]. Certes, il a rejoint une famille d’esprit à laquelle il appartenait par son penchant naturel pour la solidarité humaine. Mais dans cette lettre il fait montre d’un zèle très poussé dans le sens de l’orthodoxie communisante, sacrifiant au rituel de l’autocritique et cumulant les stéréotypes de langage.
L’autocritique concerne, sans trop de précision, sa création d’avant le changement de 1933-1934, c’est à dire son activité avant-gardiste. Mais pour que l’autocritique passe, il faut que le postulant » surenchérisse sur sa culpabilité, fût-elle imaginaire, et Voronca déclare s’être débarrassé de « la poésie précieuse et prétentieuse réservée à un nombre réduit de lecteurs » et de « la littérature réservée à quelques fils à papa pommadés et méprisants pour le reste de l’humanité ». Voronca sait bien qu’il peut compter sur la lecture complice de Sașa Pană, car les horribles forfaits qu’il feint d’assumer comme étant les siens, faisaient au contraire l’objet de son combat pendant les années, une dizaine, de frénétique activité au sein de l’avant-garde roumaine.
Un autre poncif repris dans cette lettre: la vision manichéenne portée au sein même de la gauche qui apparait scindée en deux camps adverses irréductibles: d’un côté les bons communistes Éluard, Aragon, Guillevic, de l’autre, Breton et les surréalistes, dont l’ami qui a accompagné les débuts du poète Voronca, le peintre Victor Brauner, et leur „politique trotzkiste criminelle”. Le dernier mot est rajouté après coup, entre les lignes.
Enfin, la description de sa vie privée est coulée elle aussi dans le moule de l’orthodoxie partinique: Colomba, la femme dont il s’est séparé, „est restée une grande camarade”, et qu’on se rassure, elle est la compagne du poète communiste Guillevic.
Dans l’ambiance de suspicion généralisée qui régnait après la guerre, Voronca s’en doutait que sa lettre allait avoir et d’autres lecteurs que celui auquel elle était adressée, et, face aux exigences idéologiques du moment il fallait montrer patte blanche. Et en effet, Sașa Pană s’avère un bon relais : dans la livraison du mois de février 1946 de la revue Orizont[16] qu’il dirige depuis novembre 1944, annonçant la visite en Roumanie du poète Ilarie Voronca, il traduit et reprend le passage où Voronca se déclare poète engagé. Pour être encore plus convaincant, Sașa Pană traduit engagé par « enrôlé »(înrolat). En Roumanie, Voronca donne deux conférences, une sur les poètes français, l’autre sur Romain Rolland, et lors de sa réception à la Société des écrivains roumains, il lit, d’après le compte rendu du journal Victoria (An II, jeudi 7 février 1946) « des poèmes d’Aragon et de Gabriel Pery (sic !), poètes français communistes et combattants antihitlériens ». Le public est formé d’écrivains avec ou sans responsabilités officiels, mais tous agréés par le nouveau pouvoir. Ils sont à peu-près les mêmes à participer au banquet offert au poète le soir du 2 février 1946.
Voronca n’a laissé aucune relation de son séjour en Roumanie. Il écrit, pour les Cahiers France-Roumanie le récit de son voyage à l’allée, Les yeux libres[17]. Le départ se fait sous les meilleurs auspices : « Le 8 janvier 1946 restera comme une date mémorable de ma vie. Il y a peut-être, pour moi, une prédestination de bon augure dans le chiffre 8. Je suis né un 17. Et c’est un séjour de dix-sept jours que j’ai effectué en Roumanie (et 7 et 1 font 8). C’est le 8 mai que l’Allemagne a capitulé et c’est le 8 août qu’a eu lieu la capitulation du Japon. C’est le 8 janvier 1946 que j’ai pris place dans le Simplon à destination de la Roumanie. C’était pour la première fois depuis la guerre que le Simplon reprenait la route à travers l’Europe ». Le Journal évoque brièvement les conditions rudes du voyage dans une une Europe marquée par six ans de guerre : « J’ai traversé le continent tantôt dans des voitures à bestiaux, tantôt dans des wagons Pullman. J’ai couché un jour dans un palace, le lendemain dans une grange. J’ai passé d’une rive à l’autre rive sur des bacs improvisés. J’ai attendu, dans les caves englouties sous la neige, des trains qui tardaient à venir, j’ai senti le froid me pétrifier dans d’hostiles salles d’attente ».
Mais l’heure est à la joie, au bonheur, à l’enthousiasme, car le monde a recouvert la liberté : « Les yeux libres ! il me semble que la plupart de mes contemporains commençaient à ne plus se rendre compte du grand bonheur que leur a donné la victoire militaire sur le fascisme. Marcher dans la rue, rencontrer et regarder son semblable sans voir en lui un délateur, un messager de la mort, monter dans un train sans craindre le gendarme ou l’agent de la Gestapo, se coucher, la nuit, déshabillé dans un lit et non pas équipé pour qu’à la première alerte on puisse sauter par la fenêtre ! ». Le poète vit avec exaltation le constat que partout les gens rencontrés portent la France dans leur cœur : « Je dois le dire dès le début : dès que j’ai été en terre étrangère, dès la Suisse, et encore plus ensuite, en Italie et en Yougoslavie, j’ai pu me rendre compte de l’amour immense qu’inspire la France. Nul diplôme, nul certificat de bonne conduite, nul titre honorifique n’avaient pu me servir d’avantage qu’un passeport français ». La Roumanie aussi, malgré les années de guerre et malgré une alliance malheureuse, n’a pas été détournée « de ses affinités naturelles ». Dans l’express Timisoara-Bucarest un ingénieur roumain cite Aragon (« Et si c’était à refaire, je referais ce chemin ») et déclare connaître la poésie d’Aragon et d’Éluard, alors qu’un commandant soviétique, agronome de son état, l’entretien sur Balzac, Stendhal et Proust.
L’article est écrit après le retour de Roumanie, sans doute au moment où il portait les dernières corrections sur le dactylogramme de son journal, lorsque ses résolutions étaient prises. Rien de son trouble profond ne transparaît dans l’article, si ce n’est cette allusion fugace aux échecs et malheurs personnels qui devraient s’effacer devant la grande reconquête de la liberté qu’apporte la fin de la guerre : « Certes, une fois close cette ère de l’obscurantisme et de l’angoisse, d’autres malheurs peuvent guetter un humain : il peut échouer dans son travail, par exemple ; être abandonné par un ami ou avoir une forte déception, mais que sont ces malheurs comparés avec le bonheur de se sentir libre, de découvrir le visage serein de l’univers ! ».
Le Journal
Dans ses archives recelant d’inépuisables trésors ayant trait à l’avant-garde roumaine dont il a été un des protagonistes en tant que poète, auteur de textes théoriques, directeur de revue et éditeur d’une bonne partie du corpus avant-gardiste, Sașa Pană gardait précieusement ce qu’il appelait „la cassette Voronca”. Il y avait des poésies, les lettres que le poète lui avaient adressées au fil des années et enfin deux manuscrits plus volumineux que Sașa Pană avait reçu des mains de Colomba lors d’une visite à Paris, à l’occasion du cinquantenaire du Mouvement Dada: il s’agit du Petit manuel du parfait bonheur et du Journal. Mettant à profit un moment de relâchement de la censure, le Petit manuel a pu voir le jour en édition bilingue (1973). Dans son sillage d’autres titres seront écoulés par Sașa Pană coup sur coup:
Antologia literaturii române de avangardă. Și câteva desene din epocă, 1969, la première anthologie qui a réintroduit l’avant-garde roumaine dans le circuit facilitant la connaissance du phénomène et une timide relance de la recherche ; une nouvelle édition enrichie des premiers poèmes de Tzara : Primele poeme ale lui Tristan Tzara, urmate de Insurectia de la Zurich, 1971 ;
deux tomes recueillant poésies de Ilarie Voronca, Poeme alese, 1972 ;
et ses propres mémoires : Născut în ‘02/Né en ’02, 1973.
Quant au Journal, l’autre manuscrit inédit de Voronca, il devra attendre encore quelques décennies.
Cependant, Sașa Pană, aidé par son fils Vladimir, entame au début des années 1970 le travail préparatoire en vue de la publication du Journal de Voronca, mais renonce aussitôt[18]. Si, à l’époque de la félicité obligatoire, un livre sur le « parfait bonheur » peut passer, le journal d’un suicide, même remontant vingt-cinq ans en arrière, n’a aucune chance. Cependant, Sașa Pană a rédigé un court texte sur son vieil ami „Edy” et une description du manuscrit du Journal et du dactylogramme que le poète avait pris soin de faire:
„Auprès du cadavre on a trouvé un petit paquet avec des manuscrits. Maintenant il est devant moi: une double enveloppe contenant 50 feuillets arrachés dans un carnet bloc-notes ayant à peu-prés le format d’une page de cahier. Le texte – écrit à l’encre noire recto-verso, les pages numérotées correctementjusqu’à 100 – continue sur un cahier qui commence avec la page 101. Suivent 53 pages non-cotées (s’agissant d’un cahier, il n’y avait pas le danger que les feuilles s’emmelent) et le texte s’interrompebrusquement, la dernière page n’arrive pas au point final. Les pages du cahier sont écrits avec la même encre et, semble-t-il, plus précipitamment, comme si Voronca craignait de ne pas avoir le temps de dire tout ce qu’il voulait. Il n’y a pas beaucoup d’intervention. Comme si c’était des pages copiées dans un livre ou dictées. Oui, dictée!
Avec ces feuillets-manuscrit il y avait, dans une chemise en papier vert, le même texte dactylographié sur papier fin et très serré (60 lignes par page). C’est la raison pour laquelle les 153 pages de manuscrit tiennent en 35 feuillets. Les coquilles, Voronca les a corrigé lui-même à l’encre. Le texte du dactylogramme est conforme au manuscrit, mais s’arrête avant la phrase inachevée. Il n’y a que très peu d’interventions de Voronca en dehors des corrections effectuées à l’occasion de la lecture du dactylogramme. Sur la chemise verte Voronca a écrit en diagonale, au crayon rouge, « Journal ». C’est le dernier mot qu’a écrit – et fermement, le crayon à bille refusant de s’y soumettre – la main du poète ”[19].
Ce dactylogramme et sa chemise verte si minutieusement décrites ci-dessus sont maintenant devant mes yeux. Le mot „Journal” est comme une balaffre oblique sur le visage de la couverture, les lettres presque incisées brillent d’un rouge vif-sang. Sașa Pană, pour plus de précision, a écrit lui-même à l’encre bleu-vert sur la même couverture: Ilarie Voronca. Ultimele pagini scrise – apoi dactilografiate – înainte de sinucidere/Les dernières pages écrites – ensuite dactylographiées – avant le suicide. Les mots inscrits à l’encre verte, comme un voyant allumé, sont là comme un rappel adressé à lui-même et qui expriment sans doute l’étonnement de Sașa Pană devant cette circonstance singulière: le poète Ilarie Voronca écrit un journal qui témoigne directement de sa volonté de mettre fin à sa vie et même d’une certaine urgence à accomplir le geste, mais il prend le temps de le taper (ou le faire taper) à la machine, de le lire et relire, de corriger les erreurs de frappe et d’opérer quelques interventions. Scripta manent. Au bord du néant, le poète se projète dans l’avenir, les livres qu’il aurait mis au monde et qu’il prépare jusqu’au dernier moment constituent sa vie de réserve.
Pour le retour en France, Voronca choisit la voie maritime „parce que les routes terrestres étaient exposées à trop de fatigues et de périls”. Dans le port de Constantza, il monte à bord du bateau accompagné par la femme qu’il est venue chercher à travers le continent, comme un chevalier errant. Elle amène coffres, valises, boîtes et ballots, „choses matérielles de sa vie”, une sorte de dot lui permettant d’entamer une nouvelle vie dans un pays lointain. Le bateau ne quitte Constantza qu’après trois jours et arrive dans le port d’Istanboul dix jour après l’embarquement. C’est ce dixième jour que le poète commence à écrire son journal. Le bateau et son long parcours qui relie Constantza à Marseille, passant par Varna, Istanboul, Haïfa, Beyrouth, devient le lieu d’un huis-clos où se joue le drame de l’amour asymétrique.
La femme syntaxique
Pendant les année de guerre, isolé du monde, entouré de dangers, séparé de la femme aimée, loin de ses amis, Voronca expérimente la vie en mode poétique. Les poèmes du cycle Contre-solitude et la prose poétique du Petit Manuel du Parfait Bonher se focalisent presque exclusivement, obsessivement, sur la femme aimée. Le poète bouscule la logique du Réel et bâtit un univers à partir du raisonnement poétique capable de charger le monde de Possible. Cet univers est régi par le lointain et l’absence. Et par les forces magiques de l’imagination et de la parole, de l’espoir et de l’amour, solitude et absence sont transformées en leurs contraires. La « méthode » est précisée dès le début du poème Apprentissage (Contre-solitude) :
« L’important, c’est que nous devons nous faire à cette existence d’apparente désunion, à cette impossibilité où se trouvent nos chairs de se rejoindre. Nous devons donc chercher à nous unir par la séparation même, comme un muet qui s’efforcerait de découvrir dans le silence (dans le mouvement insonore) des paroles plus éloquentes que le parler articulé. Au lieu de porter notre attention sur ce temps si court où ma main et ma bouche de chair pouvaient trouver ta main et ta bouche de chair (temps qui, par rapport au temps infini où nous aurons à nous connaître et à nous aimer en dehors de nos formes sensibles, est vraiment négligeable), habituons-nous à inventer une cohérence nouvelle où notre unité trouvera sa substance dans l’éloignement ».
Le processus continue et atteint son point d’orgue dans Petit Manuel : « J’ai modelé dans ma cachette un autre ‘toi’ »[20]. Avec la patience d’un moine savant le poète refait le monde et se montre attentif aux leçons que lui apprennent les choses et leur vie secrète :
« O ! admirable patience du bois, du fer, de la pierre de se replier sur eux-mêmes et de tisser les toiles de leurs songes. [… ] Aussi silencieuses, aussi têtues, elles s’accrochent à leur rêverie intérieure. […] Devenir comme elles indifférent au bonheur extérieur et ne rechercher que la clarté intérieure ! »[21]. Se fondre dans les phénomènes, fraterniser avec les choses, « ramener l’imagination aux proportions de la réalité ou la réalité à celle de l’imagination », laisser toute la place au rêve, « la plus vivante des réalité », tel est le programme onto poétique développé dans le Petit Manuel. Dans ce texte jubilatoire la femme lointaine prend corps et l’absence est convertie en une présence de tous les jours : « Et c’est bien de cette joie, de pouvoir, n’importe où je me trouverais, te reconstituer avec tes infimes détails, que je veux parler dans ces pages »[22]. Et un peu plus loin : « Ainsi tu nais toute vivante entre mes doigts. Tu n’es pas comme le portrait sans matière que le peintre trace sur la toile.
Tu surgis de ma propre pensée comme le muguet qui perce la neige de ma bouche. Tu es la parole qui hésite sur mes lèvres, qui oscille à droite et à gauche et qui s’envole enfin vers un être aimé »[23].
On peut dire, si l’on devait regarder ailleurs, que Voronca développe dans un livre ce constat fulgurant que Breton adresse à Lise Meyer (future Lise Deharme) le 24 septembre 1927 : « Lise, comment votre présence entière sans trace d’absence peut-elle ainsi se concilier avec votre absence ? »[24]. André Breton aime depuis trois ans une femme qui ne partage pas son amour. La forme interrogative de la phrase est liée à cette situation asymétrique de celui qui aime sans être aimé. Il reconstitue comme Voronca la femme aimée : « présence entière, sans trace d’absence », signe aussi, peut-être, chez l’un comme chez l’autre, de l’autosuffisance dans l’amour auquel Sarane Alexandrian a consacré un livre : La Sexualité de Narcisse, Le Jardin des Livres, 2003.
Le Petit Manuel du Parfait Bonheur de Voronca est un long poème incantatoire, il n’y a lieu ni d’interrogation, ni de doute, car l’amour est partagé, du moins, le poète le vit comme un amour partagé, confirmé et entretenu de temps en temps par des lettres enflammée de la part de la femme aimée. Chez Voronca, l’amour est synonyme de cosmos. L’émotion qui l’accompagne crée une intimité radieuse dans laquelle êtres et choses se répondent et se reconnaissent. Comme les mots criés par les hommes montés sur le bateau, incompréhensibles pour les autres passagers, mais qui sont « des clés qu’un ami ou un parent présumé saura saisir au vol ». L’on peut dire, avec Christophe Dauphin, que le Petit Manuel du Parfait Bonheur « est à Voronca ce que L’Amour fou est à André Breton »[25]. Voronca pousse jusqu’à une sorte d’union mystique avec l’être absent/présent, une fusion dans laquelle corps et esprit se retrouve :
« Mon souffle se mêlait au souffle de la femme adorée. Je serrais son corps près de moi et par une lente transfusion, ses bras s’insinuaient dans mes bras, sa peau, comme une fougère retrouvait l’argile de ma peau. Comme une main qui entre dans un gant, son cœur entrait dans le mien. Sa voix pénétrait dans ma bouche et parfumait mon palais. Et comme une eau qui monte dans un vase communiquant, la compréhension et l’amour de l’univers montaient en moi. Je voyais soudain que les contours de la femme étaient les contours mêmes du monde. Je communiais en même temps avec son corps et son esprit »[26].
Et pour continuer le parallèle Voronca-Breton, le Petit Manuel rencontre le commentaire situé à la même hauteur dans ce passage de Du surréalisme en ses œuvres vives d’André Breton, évoquant la femme dans le surréalisme, « incarnant la plus haute chance de l’homme » : « A ce degré il est parfaitement certain que l’amour charnel ne fait qu’un avec l’amour spirituel. L’attraction réciproque doit être assez forte pour réaliser, par voie de complémentarité absolue, l’unité intégrale, à la fois organique et psychique »[27].
Mais voilà, à l’ivresse du Petit Manuel suit, dans le Journal, le choc de la rencontre avec la femme réelle sur laquelle le temps a laissé des traces : « Pense-t-il, le chercheur d’or, à la gangue dont l’or, hantant son rêve, devra être lavé ? Il est vrai que lorsque j’ai ouvert la porte qui était la dernière muraille murée (Ah ! que les murailles faites de la matière la plus dure – le granit ou le silex par exemple – sont donc faibles par rapport à celles qu’élève en apparence, la substance immatérielle du temps !) se dressant entre moi et la femme, et que j’ai pris celle-ci dans mes bras, ce n’est pas la femme réelle, qui était devant moi, que j’ai embrassée, mais celle que durant six années j’ai portée dans mon esprit. C’était la femme d’avant la séparation que je cherchais. La femme de maintenant m’offrait les rides de son visage comme celles de son âme mais moi, je m’obstinais à ne pas les voir ». Ce n’est pas le seul changement. Le sixième jour du voyage, pendant une escale plus longue que prévue dans le port bulgare de Varna, le poète constate la métamorphose qui augure mal : « ce regard éperdu d’amour que j’étais allé chercher après six ans », « ce regard de possession exclusive » qui l’enchanta autre fois s’était effacé. Dans celui de maintenant il y avait « moins d’affection, moins d’indulgence ; dans les gestes, une impatience, une vague tristesse qui recouvrait les yeux adorés d’où jaillissait autrefois, à ma seule approche, la flamme de la joie et du bonheur ». Nous sommes au cœur du drame qui se joue : la nouvelle Galathée se révolte contre son Pygmalion, elle repousse son amour trop exclusif et trop possessif : « – Tu m’exaspères à la fin avec tes manies et tes observations continuelles d’aimer, de ne pas aimer, et ta conjugaison du verbe aimer à tous les temps et à toutes les personnes. Non vraiment ce n’est pas ainsi que j’ai imaginé la vie avec toi. Ce n’est pas ainsi que j’arriverai à t’aimer… ».
Les deux amants se trouvent sur deux « niveaux de réalité » différents étanches à tout échange. L’amour prend parfois cette forme d’incommunicabilité radicale. Le poète, qui a pour seul référent l’univers poétique de tous les possibles, est convaincu que la situation à laquelle est confronté s’explique par l’affaiblissement de sa puissance créatrice : « Et n’ai-je pas oublié, dans le tangage de ma passion, la façon de manier une plume ? Si je pouvais encore inventer des fictions adorables, peupler le monde d’autres Rovena, plus douces, plus humaines ; des Rovena repentantes qui puissent reconnaître leurs torts, demander pardon de leurs erreurs passées, s’engager à une conduite juste pour l’avenir ; inventer un autre navire, semblable à celui où je me trouve mais qui nous conduise, la Rovena de mon esprit et moi-même, vers une contrée d’éternelle félicité. Mais la Rovena que j’ai retrouvée est si différente de celle qui aurait pu faire mon bonheur. N’est-ce pas parce que ma puissance créatrice a diminué ? Ah ! si j’étais encore le poète de mes jeunes ans, je saurais transformer cette femme. Si mon imagination avait encore assez de force elle pourrait exalter le visage de Rovena. Elle existe Rovena ; elle est vivante comme une statue qui ne demande qu’un souffle brûlant pour être tendre, aimante, adorable. Sa beauté est, toute comme autrefois, sans pareille. Elle ne me déteste pas. Elle m’aime. Je n’ai qu’à m’enivrer de cette pensée… Mais non, j’entends sa voix : – « Je te déteste ! ». Je suis soudain seul! ». Et c’est cet affaiblissement qui est le pus insupportable.
« Voici qu’ici dans ce livre je creuse le tunnel de la libération »
Il y a longuement question, dans les pages du Journal, de la possibilité d’intervertir l’ordre du temps et même de faire fusionner passé et présent. Après avoir jubilé d’être en possession de tels pouvoirs (Petit Manuel… et partiellement Contre-solitude) le poète se laisse maintenant dévaler en roue libre la pente du désespoir, du désamour, du désenchantement. Tout est perdu, l’univers s’assombrit. Veuf et inconsolé, au milieu de la mer, la complainte du poète prend des accents maldororiens : « La solitude de la mer était l’immense miroir de ma propre solitude. Ah, celui qui te contemple ignore tout des songes qui te tourmente, toi, seul, et triste océan. Celui qui voit mon visage, comment saurait-il que, plus que les veines et les chairs sanglantes, un nom, une voix, un sourire adoré, se cachent sous ma peau ? Les pêcheurs qui reviennent, les barques pleines, parlent des êtres étranges qui fendent les profondeurs. Mais que savent-ils de tes désirs, de tes nostalgies, de tes projets de bonheur, toi seul et triste océan ? ». La mer, consultée comme un oracle, donne des réponses énigmatiques à la manière de la Pythie d’Apollon de Delphes : « Si je me demande : – Rovena m’aimera-t-elle ? La mer est là pour répondre : me voici. Si je me demande : – Pourrai-je encore être heureux ? La mer me répond : – Je suis là ! Que dois-je faire de ma vie ? crié-je aux mouvants horizons de l’eau et la mer me répond : Je suis la présence unanime ». Le récipiendaire interprète l’oracle en accord avec son penchant intime : « Alors ? Oui, la mer. Je n’ai qu’un pas à faire, même pas un pas, me pencher un peu sur la balustrade du pont et je me mêlerai à ces flots grincheux ». Voici la solution, l’immersion dans les profondeurs de la mer, « parmi les serres de fleurs exotiques et les grandes cages où des oiseaux liquides chantent un hymne d’amour », là où règne, omniprésente et insaisissable Amphitrite, celle qui, par ses charmes irrésistibles, attire chez elle l’autre poète, Gherasim Luca. La féérie marine est un nouveau mirage qui pourrait s’avérer aussi douloureux que celui que lui a tendu sa Rovena réelle, car « le bienheureux noyé pourra voir sa radieuse Rovena ».
Nombreux sont les témoignages de ceux qui ont connu Voronca et de ceux qui l’ont approché (quelques uns sont recueillis dans ce livre) qui attestent les pulsions contradictoires de l’homme chez qui jubilation et angoisse se succèdent sans transition. Dans ce Journal, véritable carnet de bord d’un naufrage imminent, l’auteur trouve les ressources de l’humour, de l’ironie et de l’auto ironie. Il joue le dandy tragique et nargue la mort lorsqu’il passe en revue les différentes méthodes de la joindre, se noyer, s’ouvrir les veines, se jeter sous les roues du métropolitain, aussitôt repoussées. Ou lorsque, dans une page d’inflammation égotiste, sorte de délire mégalomaniaque simulé, compose une tirade à sa propre gloire, incompatible avec ce qui lui arrive : « Comment est-ce possible qu’une telle chose m’arrive à moi ? â moi qui ai écrit des poèmes, qui ai publié des essais philosophiques, à moi qui suis doué de tant de qualités, à moi que seuls le plaisir et la joie devraient visiter ? […]Voyez-vous, moi qui connais si bien les poèmes de Mallarmé ou la théorie évolutionniste de Darwin, le discours de la méthode de Descartes, la poésie ininterrompue ou circonstancielle de Paul Éluard, moi […] le sensible, l’intelligent (et pourquoi pas ?… le beau ?) me voici méprisé par une femme. Mais elle devrait ramper devant moi ». Il pourrait, maître de son art, transformer cette histoire vraie en une fiction, avec un Ilarie Voronca inventé et une Rovena inventé. Une autre variante est évoquée, encrée dans la poésie et le symbolique : creuser un trou dans le corps de la femme, « pour qu’à travers il puisse revoir le ciel de sa liberté » : « Quand j’aurai beaucoup creusé en toi, quand tu seras comme une branche de noisetier dont le berger fait une flûte, brusquement, le chant de l’amour résonnera. Je m’échapperai de toi comme un enfant qui va naître traverse les chairs de sa mère ».
Le Journal écrit sous les yeux du lecteur est ce trou, ce tunnel, cette fenêtre par laquelle Ilarie Voronca s’échappe dans le ciel de la liberté.
Comment s’en sortir sans sortir ? Voici la question que Voronca se pose, anticipant sa formulation par Gherasim Luca. Il veut aller jusqu’au bout, Voronca, mais il veut aussi tout partager, tout dire, et son récit témoigne jusqu’au delà : l’expérience des limites en transmission directe. Une nuit il ouvre le gaz et va jusqu’aux frontières de la mort. Des êtres bizarres, décorporés, envahissent la pièce :
« Ce qui me frappe surtout c’est de constater qu’ils n’ont qu’une seule dimension. Ni volume ni surface. Tantôt c’est une bête toute en largeur (sans hauteur ni longueur) tantôt une autre toute en hauteur (sans longueur ni largeur) tantôt une autre toute en longueur.[…] C’est bien cela : ils ont des regards sans yeux, des touchers sans doigts, des goûts sans palais, des odorats sans organes olfactifs. Ce sont des cohortes maintenant qui se déversent. Bientôt je ne pourrai plus respirer tant leur masse est compacte. Ah ! voici donc les êtres parmi lesquels j’aurai à vivre dorénavant. Vivre ? Et moi qui croyais mourir. On ne cesse donc jamais de vivre ? Serions-nous éternels ? Et ne ferions-nous que passer de souffrance en souffrance ? […] Que faire cependant parmi ces foules sans poids, sans bruits qui guettent ma dépouille ? Et les reconnais-je avec le peu qui me reste de vie, ou le peu que j’acquiers de la mort ? Qu’ai-je donc cherché dans la mort ? Si c’est l’oubli, où est donc la preuve que la mémoire ne survit pas dans un cadavre comme les ongles et les cheveux qui continuent de pousser ? Peut-être me souviendrai-je et souffrirai-je encore davantage une fois mort que vivant ? Peut-être cette souffrance que m’inflige le mépris de Rovena est-elle un commencement de l’éternité de la mort ? Et ce n’est pas avec la vision de son visage et du supplice qu’il m’inspire que je devrai rejoindre les ténèbres mais au contraire avec quelque apaisant souvenir n’ayant aucun rapport avec mon malheureux amour. Mais les monstres sortis des murs continuent à m’étouffer. Est-ce pour être leur proie que j’ai ouvert le gaz ? ».
Nous sommes en présence d’une atopie – du grec atopos, formé d’un alpha privatif et du mot topos, lieu, place, emplacement, endroit. Un hors lieu, un endroit qui n’a pas lieu d’exister dans lequel le sujet est amené par intoxication au gaz et l’hallucination qui s’ensuit. Dans Moartea moartă (publié en roumain en 1945, le texte est réécrit en français par l’auteur, La Mort morte, et publié en 1994 devient son premier livre posthume), Gherasim Luca entreprend lui aussi le récit d’un événement que l’on pourrait qualifier d’atopie : les cinq tentatives de suicide accompagnées par cinq « lettres d’adieu » et par autant de textes griffonnés pendant chaque tentative. Il s’agit à la fois d’un geste poétique et d’un acte symbolique (donc effectif), la négation et l’anéantissement de la mort, par lesquels s’effectue le passage de la condition œdipienne qui tient l’homme en otage depuis toujours à la position révolutionnaire non-œdipienne, synonyme d’émancipation, de liberté et de « dépassement humain ». Le film Near Death Experience (2014) de Benoît Delépine et Gustave Kervern met en scène plusieurs tentatives de suicide dans une ambiance qui convoque tragique, dérision, insignifiance, humour, burlesque, les marques du modernisme extrême[28]. Bien que Michel Houellebecq ne soit ici qu’interprète, la proximité avec l’univers de son œuvre est incontestable, ainsi l’on peut dire que l’acteur MH incarne l’écrivain MH. Luca et Houellebecq, poètes sombres, donnent à cette aventure dans la proximité de la mort une portée lumineuse et une touche d’humour rédempteur. Ni l’un ni l’autre ne méprise et ne craignent les postures ridicules. En présence de la mort vraie symbolique ou feinte il ne s’agit plus de prendre une distance esthétique. La mort a la victoire facile. Les poètes, les rêveurs, les iconoclastes, les hérésiarques, les révoltés, les suicidés rendent la mort fragile.
Ilarie Voronca, enthousiaste (dans le sens de l’étymon grec du mot, possédé par un dieu) dans la joie et dans la détresse, suit inlassablement son étoile fixe, le bonheur. La dernière phrase du manuscrit n’a pas été reprise dans le texte final du dactylogramme. Elle est restée inachevée, care en effet, le poète est en train de recommencer à écrire son Petit Manuel du Parfait Bonheur. Ce livre est à la fois le prélude et l’épilogue du Journal.

Oui, je sais il y a les cuisses, le ventre, la courbe soyeuse des seins : mais quel effort de l’imagination te faut-il pour
P
[1] Pour le lecteur français ces textes sont accessibles dans La Réhabilitation du rêve. Une
Anthologie de l’Avant-garde roumaine par Ion Pop, Maurice Nadeau/Institutul Cultural Român/EST-Samuel Tastet éditeur [Paris], 2006. (AAR)
[2] Ilarie Voronca, Despre poem și antologie/Sur le poème et l’anthologie, Integral No. 13-14, juin 1927, in AAR, p. 173.
[3] Arthur Rimbaud, Œuvres complètes, Edition établie par André Guyaux, avec la collaboration d’Aurélia Cervoni, Gallimard, Bibliothèque de la Pléiade, 2009, p. 301.
[4] Située 13 rue Méchain, Paris, 14-ème arrondissement, l’imprimerie Union a été fondée en 1910, par deux exilés russes, Volf Chalit ( 1878, Moscou-1956, Sceaux) et Dimitri Snégarof (1885, Vitebsk-1959, Paris). C’est ici que sont imprimés Les Cahiers d’Art de Christian Zervos (1926-1933), les publications du groupe surréaliste La Révolution surréaliste (le dernier numéro, décembre 1929) et Le Surréalisme Au Service de la Révolution (tous les numéros), ainsi que la revue Minotaure. La Collection Integral comporte de Ilarie Voronca : Colomba, avec deux portraits de Robert Delaunay et la couverture de Sonia Delaunay, 1927 ; Ulise (Ulysse), avec un portrait de Marc Chagall, 1928 ; Plante și animale (Plantes et animaux), dessins de Constantin Brâncuși, 1929 ; de Geo Bogza : Jurnal de sex (Journal de sexe), 1929 ; de Stephan Roll : Poeme în aer liber (Poèmes en plein air), avec dessins de Victor Brauner, 1929.
[5] Benjamin Fondane, Marc Chagall, in Brancusi suivi de Marc Chagall, éditions marguerite waknine, 2011, p. 35.
[6] En faite, l’initiative appartient à Stefan Roll, gagné à l’intransigeance dogmatique du Parti communiste clandestin. Sașa Pană le suit sans trop de conviction, et c’est lui qui renoue avec Voronca après la guerre.
[7] Sașa Pană, Născut în 02/Né en O2, Editura Minerva, Bucarest, 1973, p. 321.
[8] Ilarie Voronca, lettre à Geo Bogza, 7 novembre 1932, in Epistolar avangardist/ Épistolaire avant-gardiste, Edition et postface par Madalina Lascu. Avant-propos par Ion Pop, Éditions Tracus Arte, Bucarest, 2012, p. 240.
[9] Ilarie Voronca, lettre à Geo Bogza, 16 novembre 1932, op. cit. p. 241.
[10] André Breton, Œuvres complètes, Edition établie par Margueritte Bonnet, Gallimard, Bibliothèque de la Pléiade, tome I, p. 344.
[11] Ilarie Voronca, Intre mine și mine/Entre moi et moi, unu No. 19, mai 1929, in AAR, p. 189-198.
[12] Mircea Eliade, Fragments d’un journal. Traduit du roumain par Luc Badesco, Gallimard, 1973, p. 12.
[13] Christophe Dauphin, ILARIE VORONCA. Le poète intégral, Rafael de Surtis/Editinter, 2011.
[14] Cf. Christophe Dauphin, ILARIE VORONCA. Le poète intégral, ed.cit., p. 156.
[15] Sur cette question voir Christophe Dauphin, ILARIE VORONCA. Le Poète intégral, ed. cit. p. 194-195.
[16] Orizont. Littérature, art, culture, pensée sociale. 42 nos du 1er novembre 1944 jusqu’en mars 1947. Dans la presse de l’époque était présentée comme la première revue de culture et littérature pour travailleurs et intellectuels.
[17] Cahiers France-Roumanie, avril-mars 1946, p. 7-12.
[18] Vladimir Pană, Notă asupra ediției in Ilarie Voronca, Jurnalul sinuciderii, Tracus Arte, Bucarest, 2016, p. 3.
[19] Sașa Pană, Cu privire la Jurnalul lăsat de Voronca, op. cit. p. 10-11.
[20] Ilarie Voronca, Petit Manuel du Parfait Bonheur/Mic Manual de Fericire Perfecta, [édition bilingue]. Traduit du français par Sașa Pană. Les Éditions Cartea Românească, Bucarest, 1973, p. 42.
[21] Idem, p. 46 et 48.
[22] Idem, p. 114.
[23] Ibidem, p. 126.
[24] In Georges Sebbag, André Breton, 1713-1966. Des siècles boules de neige, Nouvelles Éditions Jean-Michel Place, Paris, 2016, p. 148.
[25] Christophe Dauphin, op. cit. p. 134.
[26] Ilarie Voronca, Petit Manuel…, éd. cit., p. 142.
[27] André Breton, Manifestes du surréalisme, Gallimard, 1973, p. 184.
[28] Je préfère le syntagme de Gilles Lipovetsky « modernisme extrême » au terme « postmodernisme », dont le domaine est mal défini.
